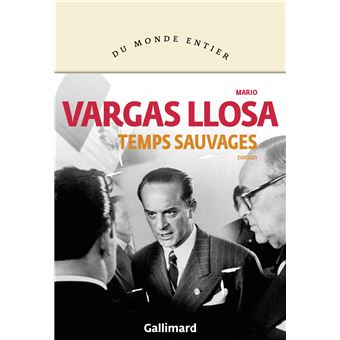Le 25 novembre 2021 Mario Vargas Llosa a été élu à l’Académie française. D’aucuns ont fait remarquer que le prix Nobel de littérature n’avait jamais publié en français même s’il le parle. Il a d’ailleurs habité à Paris, et écrit des livres se déroulant dans la capitale. D’autres se sont opposés par tribune contre ce choix, car Vargas Llosa venait de prendre position en faveur du candidat de la droite et de l’extrême droite à l’élection présidentielle chilienne. Cette tribune est surprenante parce qu’on devrait plutôt voir une réelle cohérence dans la volonté de Vargas Llosa de siéger sous la Coupole. Il est en effet connu de longue date comme libéral mais pas comme défenseur du fascisme. Il a été candidat à l’élection présidentielle péruvienne en 1990 contre Alberto Fujimori qui l’avait largement battu. Même pour des personnes de gauche, la défaite de Vargas Llosa n’était pas une bonne nouvelle, car son concurrent s’est révélé être une franche crapule au point d’écoper par la suite de vingt-cinq années de prison. Quoi de plus normal donc que Vargas Llosa postule à une institution totalement réactionnaire. Car comme le rappelle la linguiste Laélia Veron (voir la vidéo), l’Académie est non seulement une congrégation dont les membres n’en foutent pas une rame, mais aussi une institution qui se complaît à accueillir toutes les facettes de la réaction. Ils viennent toutefois de se réveiller en menaçant de saisir la justice pour protester contre la nouvelle carte d’identité bilingue. Peut-être faudra-t-il leur révéler que ce document est aussi utilisé à l’étranger, une zone où horreur tout le monde ne parle pas français. Question identité politique, ils font fort. VGE, qui n’a jamais écrit autre chose que des histoires de culbuteries princières, y a siégé. Les curés y ont leurs places réservées. Alors si Vargas Llosa souhaite se déguiser en petit homme vert, s’il prend plaisir à s’asseoir à côté de Finkielkraut, c’est juste une faute de goût. Il faudra toutefois lui préciser que les académiciens n’ont d’Immortels que le nom. Qu’on leur a probablement attribué ce patronyme parce qu’ils intéressent si peu les lecteurs, qu’une fois décédés, personne ne s’en aperçoit. Vargas Llosa au moins restera avec son œuvre dans l’histoire.
C’est en quelque sorte la suite de son fabuleux La fête au Bouc qui raconte la vie de Rafael Léonidas Trujillo
Pour ceux qui en douteraient, en publiant Temps sauvages Vargas Llosa confirme à quatre-vingt-cinq ans son attachement à la démocratie ainsi que son immense talent. Dans un panorama de l’Amérique latine récemment livré aux Échos il jette un regard critique sur la corruption du continent. Il souligne les dégâts commis par les populistes, Bolsonaro au Brésil ou le président du Salvador qui vient de faire du bitcoin sa monnaie nationale. Vargas Llosa n’apprécie pas non plus le Brésilien Lula ni le Nicaraguayen Daniel Ortega, on s’en serait douté. Il déplore le rôle joué par la Chine qui est devenu le premier investisseur du continent. Temps sauvages est un livre foisonnant où on se perd parfois avant de trouver sur la fin les éléments qui semblaient manquer. C‘est l’histoire du Guatemala à la sortie de la seconde guerre mondiale. Une période propice dans toute l’Amérique latine aux coups d’État fomentés par la CIA. Une époque où les dictateurs ont parfois remplacé des présidents démocratiquement élus, mais bien plus souvent d’autres dictateurs. C’est en quelque sorte la suite de son fabuleux La fête au Bouc qui raconte la vie de Rafael Léonidas Trujillo, celui qui a dirigé d’une main de fer pendant trente années la République dominicaine. Trujillo est d’ailleurs un personnage important de Temps sauvages, comme il l’était aussi dans la saga dominicaine de Catherine Bardon, notamment dans Les Déracinés. L’explication est simple : le Dominicain a longtemps été un modèle pour les autocrates sud-américains, par la durée de son règne, la qualité de sa police politique, et sa capacité à résister aux Américains. Car pendant longtemps sur le continent, à la fin c’était la CIA qui décidait.
Arévalo avait pour seul but d’instaurer au Guatemala un régime démocratique calqué sur celui des États-Unis
Temps sauvages débutent avec la présentation des deux hommes qui ont eu le plus d’influence sur le destin du Guatemala au XXe siècle. Ils s’appellent Edward L. Bernays et Sam Zemurray. Zemurray était un Juif de la mer noire né en 1887, une époque de terribles pogroms russes. Il émigra avec sa tante aux États-Unis comme le fit aussi Bernays. Également juif, Bernays était d’un tout autre niveau social en tant que neveu de Sigmund Freud. Il se voulait d’ailleurs l’inventeur des relations publiques. Les deux hommes se rencontrèrent pour la première fois quand Bernays reçut Zemurray dans son bureau de Manhattan. Un dandy faisait face à un péquenot. Le plus important économiquement parlant n’était toutefois pas celui dont les habits brillaient. C’était Zemurray, celui qui importait des bananes d’Amérique centrale via l’entreprise qu’il avait créée : United fruit. Une firme devenue tentaculaire et qui n’avait que peu d’équivalents dans le monde. Zemurray qui peinait à écrire une lettre, voulait embaucher Bernays pour qu’il s’occupe des relations publiques de son entreprise. Bernays améliora grandement l’image de la Pieuvre en faisant construire quelques écoles et dispensaires au Guatemala, et plus encore en ralliant à United Fruit l’aristocratie de Boston. À la fin de la seconde guerre mondiale Zemurray et Bernays s’efforcèrent de faire croire à l’opinion publique américaine que le président guatémaltèque Arévalo, le premier élu démocratiquement, allait transformer son pays en cheval de Troie de l’Union soviétique. C’était totalement faux car Arévalo avait pour seul but d’instaurer au Guatemala un régime démocratique calqué sur celui des États-Unis avec liberté de se syndiquer et pire encore refus des monopoles. Il souhaitait aussi améliorer la vie des Indiens qui constituaient la majorité de la population guatémaltèque. En 1950 Jacobo Árbenz Guzmán, le fils d’un pharmacien d’origine suisse, succéda à Arévalo avec pour principale promesse la réforme agraire. Une décision qui nuisait gravement à United Fruit le premier propriétaire foncier du pays.
Au pays la réforme agraire avait été abolie, et on traquait les communistes comme l’Inquisition avait su le faire
En 1954 le président américain Eisenhower décida de déboulonner par les armes Árbenz en s’appuyant sur un militaire local le colonel Castillo Armas dit Face de hache. Quand on le regardait on voyait d’abord sa petite moustache qui rappelait celle d’Adolphe Hitler. Pour réussir son coup d’État Eisenhower avait pour atout, les deux frères Dulles qui étaient secrétaire d’État et chef de la CIA. Ils étaient aussi anciens fondés de pouvoir de United Fruit, une entreprise peu encline au changement car elle n’avait jamais payé d’impôts en cinquante années d’activité au Guatemala. De Trujillo en République dominicaine à Somoza au Nicaragua et au président du Honduras, tous les dictateurs de la région furent sollicités par Face de hache pour qu’ils l’aident à se débarrasser du communisme. Cela fonctionna si bien que Castillo Armas parada en 1955 à New-York en tant que président du Guatemala. Au pays la réforme agraire avait été abolie, et on traquait les communistes comme l’Inquisition avait su le faire avec les impies dans des temps anciens. D’ailleurs l’Église catholique n’avait pas beaucoup changé, elle détestait toujours autant les déviants qui étaient désormais les rouges. Les démocrates comme le docteur Efrén Garcia Ardiles ne pouvaient comprendre comment les États-Unis, pays de la liberté, aient pu soutenir un factieux aussi médiocre que Castillo Armas. Et plus encore des propriétaires terriens racistes ainsi que l’United Fruit. Mais un simple médecin comme Ardiles ne comptait pas dans le pays, surtout quand il dut épouser Marta Borrero Parra, une jeune fille de quinze ans qu’il avait engrossée. L’adolescente avait au contraire tout l’avenir devant elle. Elle devint mis Guatemala et par moment la véritable dirigeante du pays tant elle ensorcelait les hommes qu’elle croisait. Ils avaient beau passer leur temps au bordel en buvant du rhum Zacapa. Ils pouvaient bien être lieutenant-colonel et la coller au fond de leur lit pour « la faire couiner comme une truie » au risque de scandaliser l’association L214. Avec elle ils n’ont jamais eu le dernier mot. Quant à Vargas Llosa rassurez-vous, le bonhomme est encore vert.
L’Académie française une institution inutile
Qu’en dit Bibliosurf ?
https://www.bibliosurf.com/Temps-sauvages.html