Peut-on découvrir l’économie grâce à la littérature ? Oui ! Trois fois oui ! Pour comprendre ce qu’était la richesse Bernard Maris lisait Balzac qui pourtant en matière de finances a davantage croisé les huissiers que la réussite. Maris était également l’auteur d’un Houellebecq économiste. On pourrait aussi se replonger dans Zola pour comprendre le fonctionnement des mines au XIXe siècle avec Germinal, des grands magasins dans Au bonheur des dames, ou de la spéculation financière avec L’argent. Dans Le casse du siècle Michael Lewis, ancien de Salomon Brothers, propose une autre façon de décrypter l’économie en lien avec la littérature. Non pas en écrivant un roman, mais un long reportage sur la crise financière de 2008 en mode littéraire. Il est d’ailleurs symptomatique que ce livre ait été publié en France par Sonatine, la maison d’édition de tant d’auteurs de romans noirs. Car c’est bien de criminalité dont il est question ici. Celle des milieux financiers qui a trop vouloir se gaver et persuadés de leur intelligence, ont mis par terre une grande partie de l’économie mondiale. Un séisme que nous payons encore, car 13 ans après de nombreux territoires n’ont pas encore retrouvé leur richesse de 2008. Loin de simplifier le discours, la forme littéraire le rend accessible même si le propos demeure technique. Et c’est heureux car une leçon de la crise de 2008 est que quand ils se vautrent, nous payons. Too big to fail. Parce que les banques ont pris tant de place dans nos économies que les laisser tomber nous exposerait à des conséquences cataclysmiques.
Le bouquin vaut par sa capacité à montrer l’incapacité des marchés à s’autoréguler
Le titre originel du livre était The Big short car il raconte comment se sont enrichis ceux qui avaient anticipé une baisse des cours sur les marchés hypothécaires des Américains les plus pauvres. En langage financier être short signifie parier sur la baisse des cours d’une action, d’une obligation, d’une devise ou d’une matière première. Ce pari s’appuie sur la possibilité de vendre ces produits « à découvert ». C’est-à-dire de vendre au cours du jour un actif que l’on ne possède pas, en l’empruntant, et en le livrant plus tard. J’anticipe une baisse des cours qui, si elle se produit, me permettra d’acheter moins cher au moment de la livraison. D’où la création de mon bénéfice. En cas de hausse, j’ai perdu mon pari et je subis une perte. Pour que l’opération se fasse il faut trouver un opérateur adepte de la démarche inverse. Quelqu’un qui anticipe une hausse qui lui permettra une plus-value sur la revente de son actif. C’est un jeu à somme nulle. Le titre du livre de Michael Lewis s’est transformé en Le casse du siècle en raison des montants pharaoniques encaissés par ceux qui avaient vu juste. Bien plus que par l’explication technique de la crise, le bouquin vaut par sa capacité à montrer l’incapacité des marchés à s’autoréguler. Qu’on ne peut donc pas leur laisser les mains libres eu égard aux dramatiques conséquences de leurs errements. Le livre nous amène aussi à réfléchir sur l’incroyable bêtise de ceux qui, par appât du gain, ont conçu des produits financiers tellement complexes qu’à la fin personne ne les comprenait plus. Et surtout pas eux. Si on veut positiver Le casse du siècle a aussi un petit côté moral, car à la fin de l’histoire les plus grands gagnants ont été de petits acteurs de la sphère financière et pas ceux qui se croyaient les plus forts. L’autre leçon à tirer du livre et de la crise de 2008 est venue avec le temps. Elle nous montre que les règles prétendument inviolables sont vite oubliées. Il en va ainsi des règles budgétaires que les États européens ont mises de côté en 2008. Dans la préface de l’édition française, Guy Martinolle cofondateur de Sonatine et ancien financier se pose la question de ce qui se passera la fois suivante puisque les États ne pourront plus payer. L’actuelle crise sanitaire nous a apporté une première réponse. Les Européens se sont assis sur ce qu’on croyait être le statut de la banque centrale pour trouver des fonds. Le capitalisme est tellement résilient.
Le marché des subprime est né
En 2008 Meredith Whitney analyste de sociétés financières explique que les banquiers de Wall Street ne sont pas corrompus mais idiots. Ils ne voient pas les paquets d’obligations hypothécaires pourries qu’ils se trimbalent dans leurs comptes. Meredith Whitney avait compris. L’obligation hypothécaire est un produit financier garanti par un bien immobilier. Tant que les logements ne se déprécient pas l’acheteur est sûr de récupérer sa mise. Dans les années 80 les acheteurs de ces obligations prennent d’autant moins de risques que des agences gouvernementales s’engagent à compenser une éventuelle baisse du marché immobilier. Pourtant ces produits ne sont guère prisés des organismes financiers, car en cas de baisse des taux les emprunteurs de crédits immobilier anticipent le remboursement de leur prêt. Les détenteurs d’obligations se retrouvent alors avec du cash quand cela les intéresse le moins. D’où la création de nouveaux prêts à des clients moins solvables mais non garantis par l’État. Une nouvelle manière plus risquée de gagner de l’argent. Pour que le coût du risque ne soit pas trop élevé, ce qui augmenterait le prix des crédits immobiliers, on réunit les créances bancaires que l’on commercialise sur les marchés obligataires. Ainsi on dilue le risque. Mais deux conditions nécessaires à la viabilité de ces nouveaux produits financiers seront vite oubliées. Que les emprunteurs puissent rembourser leurs emprunts, et que le prix des logements ne s’effondre pas. Le marché des subprime est né. Ses concepteurs prétendent agir au profit des Américains les plus pauvres qui grâce à eux peuvent enfin acheter un appartement ou une maison. Au début des années 2000 les sociétés qui élaborent des prêts subprime font toutes faillite suite aux défauts de nombreux emprunteurs. Explication : elles ont conservé une partie de leurs obligations. Les auraient-elles intégralement refourguées sur le marché obligataire qu’elles en seraient sorties indemnes.
Il saisit surtout que pour gagner beaucoup il lui faut trouver les pires prêts immobiliers
Rapidement le marché repart. Toujours plus de prêts à des clients de plus en plus pauvres, immédiatement revendus aux grandes banques d’affaires. Chez elles aucun alibi social, elles savent juste qu’on gagne de l’argent sur les obligations et pas sur les actions. Une difficulté gêne toutefois les investisseurs. Pour gagner de l’argent sur le marché obligataire, il faut pouvoir vendre à découvert. Or ce n’est pas possible pour les subprime. On va y remédier avec les CDS pour Credit default swaps. Ce sont des assurances qui limitent les pertes des obligations. Les CDS sont en quelque sorte ce que sont les assurances payées par les céréaliers pour se protéger de la baisse du prix du blé. Avec les CDS, si vous percevez avant le marché la baisse du prix des obligations, vous pouvez vous assurer pour pas cher et gagner beaucoup. Mieux encore, vous pouvez acquérir des CDS sans acheter d’obligations et les vendre sans disposer du capital nécessaire pour indemniser les acheteurs. Ce sont de purs produits spéculatifs. Acheter ou vendre des CDS revient donc à faire un pari sur le futur cours des obligations. Michael Burry est le premier investisseur à le comprendre. Il saisit surtout que pour gagner beaucoup il lui faut trouver les pires prêts immobiliers. Ceux dont la baisse quasi certaine va déclencher l’assurance. Il le comprend avant la plupart des banques d’affaires américaines comme Goldman Sachs, avant la Deutsche Bank, qui toutes s’empressent de lui vendre des CDS sans même regarder sur quelles obligations elles portent. Elles font à peine varier les prix de l’assurance en s’appuyant sur le classement de l’agence de notation Moody’s et Standard and Poor’s, pourtant réputée pour son rare niveau d’incompétence. « Quand on ne trouve pas de boulot à Wall Street on bosse chez Moody’s a-t-on l’habitude de dire à New York ». En quelques semaines Burry achète pour plusieurs centaines de millions de dollars de CDS. Fin 2005 nombreux sont les Américains qui ne peuvent plus rembourser leur crédit immobilier. Goldman Sachs et la Deutsche Bank proposent à Burry de lui racheter une petite partie des CDS qu’ils lui ont vendus. Preuve que ces banques avaient compris. Elles ne sont pas exposées à la totalité des pertes parce ce qu’elles ont surtout un rôle d’intermédiaire entre le marché et les assureurs. Mais l’avenir montrera qu’elles gardent quand même une partie des obligations, en pariant parfois sur la montée des cours et parfois sur la baisse. De la folie futieuse.
AIG finira par saisir l’absurdité de son comportement mais trop tard
Le véritable enjeu se joue chez AIG, l’assureur qui est le vrai vendeur des CDS. Et chez AIG on est à côté de la plaque. Rapportés aux revenus des Américains, les prix des maisons n’ont jamais été aussi élevés. Celui des assurances CDS aurait donc dû augmenter. Or il baisse. AIG finira par saisir l’absurdité de son comportement mais trop tard. Début 2007 Grant’s, une newsletter financière publie un papier qui décrypte pour la première fois la folie du meccano financier des subprime. Un petit nombre d’investisseurs dont Steve Eisman ont rejoint Burry dans les paris sur l’effondrement du système. En juillet le marché des obligations hypothécaires subprime s’effondre. Les défauts de paiement des emprunteurs de crédits immobiliers sont désormais trop nombreux. La banque d’affaires Lehman Brothers dépose son bilan. Les cours en bourse de Morgan Stanley et de Goldman Sachs plongent. City group annonce 60 milliards de pertes. À Wall Street la catastrophe rappelle le 11 septembre 2001. Michael Burry et Steve Eisman vont empocher des dizaines de millions de dollars. En octobre le gouvernement américain annonce qu’il épongera les pertes des banques pour éviter les faillites. Elles sont sauvées mais pas l’économie mondiale. La cupidité et la bêtise des financiers américains l’ont envoyée à terre. La cupidité on s’en doutait. Le grand intérêt du livre est de mettre en avant la prétention de tous ces acteurs. C’est ce que Michael Lewis annonce dès l’entame de son bouquin en citant Tosltoï : « Les sujets les plus difficiles peuvent être expliqués à l’esprit le plus lent s’il n’en a pas déjà formé une idée ; mais la chose la plus simple ne peut être expliquée à l’homme le plus intelligent s’il est fermement persuadé qu’il sait déjà, sans l’ombre d’un doute, ce qui se trouve devant lui. ».
L’adaptation au cinéma du livre de Michael Lewis
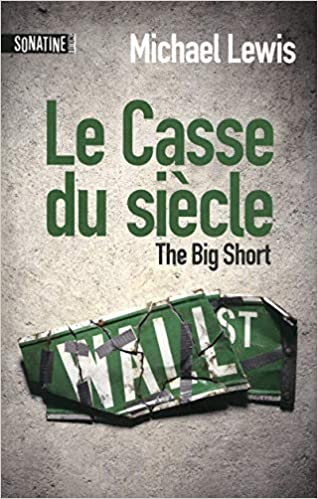
Après Made en France, un article très clair sur un sujet complexe.
Laurent ou l’art d’apprivoiser l’économie pour ses lecteurs.
🙏