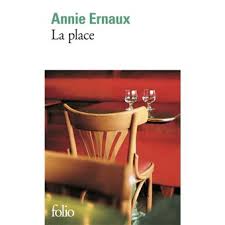J’étais obligé, je n’avais pas le choix. Comprenez, ce blog se veut littéraire et n’y figurait aucun ouvrage d’Annie Ernaux qui vient de décrocher le Nobel de littérature. Je me devais donc de m’adapter. De réparer cet oubli. Mais la vérité est que cette autrice m’a toujours plus ou moins fait peur. Elle est pourtant louée pour son écriture, classée à l’extrême gauche, féministe, décrite comme une narratrice des classes sociales qui s’inscrirait dans la foulée de Bourdieu. Elle a dit du mal de Macron et pas qu’un peu. Rien que des arguments qui auraient dû me pousser à ouvrir un de ses livres. Je l’avais d’ailleurs fait il y a quelques mois. Il était court comme la plupart des romans d’Ernaux, et je l’avais rapidement reposé. Ce n’était sans doute pas le moment. Ce qui m’a définitivement convaincu, plus que le Nobel, c’est la déclaration d’amour que lui a envoyée Nicolas Mathieu. Parce que les auteurs récompensés par le Nobel on peut parfois s’en passer. Certains sont parfaitement inconnus ou pas encore traduits, et pour d’autres on se demande dans quel état était le jury au moment du choix. Mais avec Nicolas Mathieu on ne transige pas.
Ils s’interdisaient le patois normand
La place est un ouvrage magnifique qui se lit dans l’apaisement malgré son sujet. Annie Ernaux raconte la peur de son père de perdre sa place dans la société, ainsi que son incompréhension quand il voyait sa fille s’éloigner de son milieu pendant ses études. Sa place c’était celle qu’il avait acquise avec sa femme en achetant un commerce, sortant ainsi de leur milieu d’origine. Or leur situation était précaire, à cause du crédit qu’ils devaient rembourser, mais aussi parce que s’annonçaient les supermarchés qui allaient les balayer. Ils avaient l’obsession du respect des normes sociales. Ils se demandaient tout le temps ce qu’on allait penser d’eux. Pas question de parler le patois normand même s’ils maîtrisaient avec difficulté le français. Pour le père d’Annie Ernaux, voir sa fille parler anglais avec un auto-stoppeur, l’entendre revendiquer le lavage de la salade à l’eau de javel en s’appuyant sur ses connaissances scolaires, était insupportable. Invitait-elle une amie à la maison, et son père se mettait en quatre pour ne pas déroger aux habitudes de la jeune fille. Dans le cas inverse les parents ne se posaient pas la question. Tout cela est raconté avec beaucoup de distance, de retenue, sans aucun mépris. Peut-être est-ce dû à l’allusion faite au Père Goriot en début d’ouvrage, on pense en lisant à certains romanciers du XIXe siècle. Nul besoin de chercher un cours de sociologie pour en profiter. Le récit se suffit à lui-même.
C’était la sentir partir dans un autre monde
Encore une heure et elle sera autorisée à devenir enseignante. Soixante minutes consacrées à un cours donné devant l’inspecteur et deux assesseurs au sein d’un lycée de la Croix-Rousse à Lyon. Le temps de disséquer vingt-cinq lignes du Père Goriot devant une classe de matheux de première. Deux mois après cette journée qui l’a fait rentrer dans le corps des professeurs titulaires son père meurt. Il avait soixante-sept ans et il tenait un café-alimentation près de la gare de Y… La famille défile devant le corps, lui succède une partie des habitués du bistrot. Pendant l’été elle commence un roman sur son père et elle comprend que cette forme littéraire est impossible. Pour rendre compte de sa vie, elle doit recourir à l’écriture plate, celle qu’elle utilisait plus jeune quand elle écrivait à ses parents. C’est ainsi que l’histoire commence avant le vingtième siècle dans un village du pays de Caux. Le père de son père travaillait dans une ferme comme charretier. L’homme était violent, méchant avec sa famille, c’était sa façon de résister à la misère. Lui qui n’avait appris ni à lire ni à écrire, ne supportait pas de voir quelqu’un de son entourage plongé dans un livre ou un journal. Mais il savait compter. Quand il était invité à un mariage avec sa femme, ils arrivaient sans avoir mangé depuis trois jours pour mieux en profiter. Le père de la narratrice aimait apprendre, il parvenait à lire et écrire sans faute avant que son géniteur ne le place dans la même ferme que lui. Il n’en sortira que pour aller au régiment. À la ferme il connaissait les nuits sur une paillace sans drap, au-dessus des bêtes, et d’innombrables heures de travail sur la terre des autres dont il ne voyait pas la beauté. Au retour de l’armée le choix de l’usine s’était imposé. Il était libre le soir après la sirène et ne portait plus les odeurs agricoles sur son corps. C’est au travail qu’il rencontra celle qui allait devenir sa femme. Il connaissait la condition pour ne pas reproduire la misère de ses parents : ne pas s’oublier dans le corps d’une femme. C’est elle qui eut l’idée de prendre un commerce pour s’en sortir. Ils avaient peur de manquer de fonds, de devoir vendre, alors il prit un emploi d’ouvrier pendant qu’elle faisait tourner leur affaire.
Le style d’Annie Ernaux, elle en parle bien Laélia Véron !
Abonnez-vous pour être averti des nouvelles chroniques !